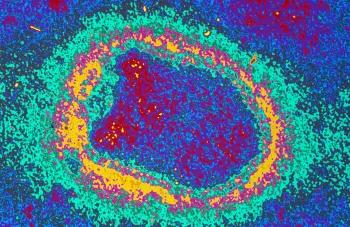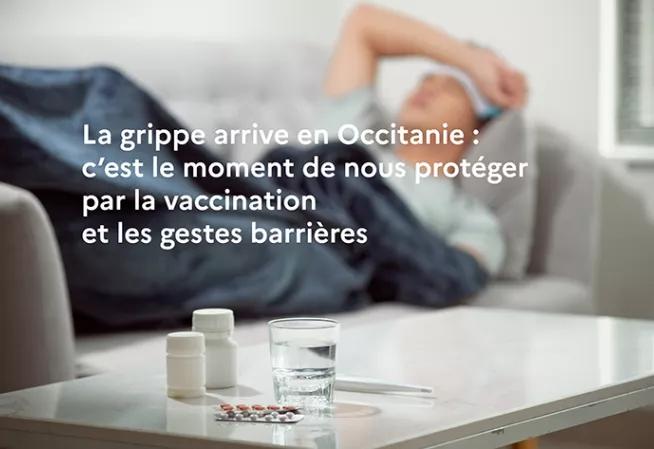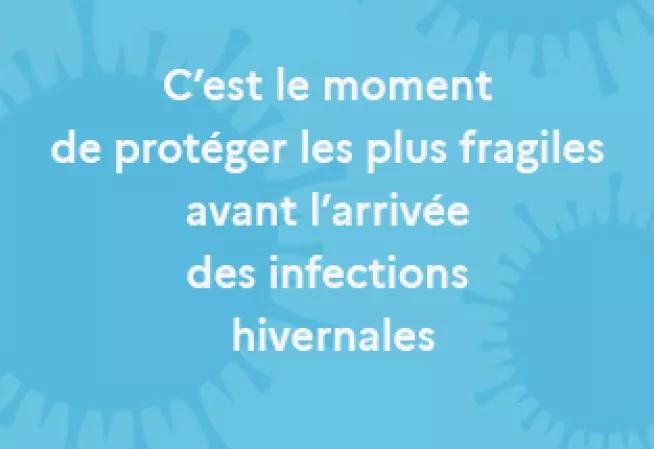Des mesures de prévention et des investigations pour déterminer l'origine de la contamination
La rage ne peut pas être transmise entre humains. Elle est transmise à l’homme principalement par les carnivores domestiques et sauvages. Le risque est lié aux morsures, griffures, contact de salive sur plaie ou muqueuse.
La rage ne circule pas en France métropolitaine. Le dernier cas "endémique" est un renard en Moselle en 1998. Après 2 ans sans aucun cas, la France est devenue officiellement indemne en 2001. Par conséquent, la contamination n’est possible que dans un autre pays où la rage circule ou en France Métropolitaine via le contact avec des carnivores domestiques importés illégalement sur le territoire et qui auraient contracté le virus dans un autre pays. Bien que la rage ne se transmette pas d’homme à homme, les personnels soignants ayant pris en charge ce patient ont été vaccinés par mesure de précaution. Ces mesures préventives ont été déployées par le Centre Antirabique de Perpignan (vaccination).
Les investigations sur la nature du virus et les modalités de contamination se poursuivent avec le Centre National de référence de la rage de l'Institut Pasteur et les équipes de veille sanitaire de l'Agence régionale de santé d’Occitanie. Ces investigations sont à ce stade toujours en cours notamment pour retracer le parcours du patient afin d’identifier les circonstances de la contamination. Cette enquête épidémiologique vise notamment à identifier les potentiels contacts avec un animal porteur de ce virus. Ces analyses portent sur plusieurs mois, du fait de la durée d'incubation du virus, dans un contexte de déplacements à l'étranger.
En parallèle et de façon préventive, l’ensemble des vétérinaires du territoire métropolitain, en lien avec les directions départementales de protection des populations, ont été informés et sensibilisés à cette situation.
Qu’est-ce que la rage ?
La rage est une maladie virale qui touche les mammifères, notamment les chiens, les chats et les chauves-souris. Le virus est présent dans la salive des animaux infectés, qui peuvent le transmettre à l’homme par morsure, griffure ou léchage d’une blessure, d’une lésion cutanée récente ou d’une muqueuse (nez, bouche, œil…).
La France hexagonale est aujourd'hui indemne de rage. Les seuls animaux autochtones infectés sur le territoire hexagonal sont des chauves-souris. Le contact avec une chauve-souris, ou son cadavre, reste un risque de contamination. D'autres animaux porteurs (des chiens principalement) peuvent toutefois avoir été introduits illégalement par des voyageurs de retour de l’étranger, malgré les contrôles aux frontières.
La rage est encore très présente dans de nombreux pays en particulier en Asie et en Afrique et tout contact suspect avec un animal dans les pays où sévit la rage doit faire l’objet d’une consultation auprès d’un médecin. La prise en charge des patients est assurée entre autres par une vaccination après exposition qui est parfaitement efficace lorsqu’elle est mise en œuvre précocement.
La rage ne peut pas être transmise entre humains.
Conseils aux voyageurs dans les zones où la maladie est présente
Prendre rendez-vous avec son médecin avant le départ. Une vaccination préventive est possible en fonction des conditions de séjour ;
A l’étranger, même s’il semble en bonne santé, un animal peut être infecté. Pour importer en France un animal de compagnie depuis un pays hors Union européenne, il convient de consulter les règles rappelées par le ministère de l'Agriculture.
En cas d’exposition à risque avec un animal à l’étranger (morsures, griffures, léchage sur muqueuses ou plaies etc), consulter un médecin le plus tôt possible. Une prophylaxie post exposition peut être débutée même plusieurs semaines après l’exposition.
Pour en savoir plus sur la maladie :
Page rage -Ministère chargé de la Santé et de l’Accès aux soins
Fiche d'informations sur la maladie – Institut Pasteur
FAQ - Ministère chargé de la Santé et de l’Accès aux soins